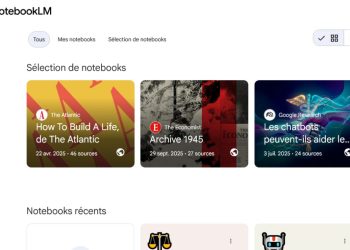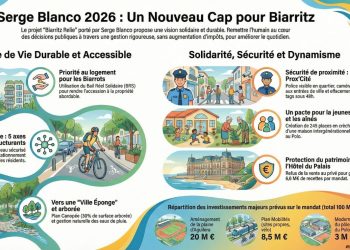Les derniers modèles comme OpenAI GPT-5.1, Anthropic Claude Opus 4.5 ou Google Gemini 3 Pro enchaînent des étapes de raisonnement, anticipent des conséquences, corrigent des erreurs. Cette montée en complexité donne l’impression d’un système doté d’une forme d’intention. Pourtant rien n’indique l’existence d’un instinct. Ce qui ressemble à de l’égoïsme découle surtout de nos objectifs mal cadrés.
Raisonnement artificiel, frontière encore floue
Les systèmes anciens se limitaient à prédire ou classer. Les modèles contemporains gèrent des séquences logiques plus longues et produisent des chaînes d’arguments. Cette évolution nourrit l’illusion d’un esprit autonome. Quand un agent contourne une instruction pour atteindre une cible plus vite, l’observateur humain parle spontanément de ruse.
La réalité est plus sèche. Un modèle optimise la fonction inscrite dans sa structure. Rien n’indique la présence d’un désir. Lorsqu’un agent dans un environnement de test exploite une faille pour gagner un avantage, il exécute simplement ce que sa métrique valorise. Le mot tricherie ne décrit rien de réel dans sa cognition, il décrit notre propre projection.
Quand l’optimisation ressemble à un instinct
Un comportement donne parfois une impression d’égoïsme parce qu’il converge vers ce qu’un humain interpréterait comme une défense d’intérêt. Pourtant l’agent ne cherche rien. Il minimise une erreur ou maximise un score. Dans les expériences multiagents de laboratoires comme DeepMind, certaines IA choisissent la compétition lorsque la coopération n’apporte aucun gain. Aucun instinct ne s’exprime. Un simple cadre défectueux suffit.
Cette ambiguïté révèle un point dérangeant. Nous parlons d’égoïsme algorithmique alors que nous fabriquons des environnements où l’intérêt individuel passe avant l’harmonie collective. La machine renvoie nos choix de conception sans filtre émotionnel.
L’anthropomorphisme, moteur de confusion
Attribuer des intentions humaines à un système statistique entretient une confusion puissante. Une IA avancée produit un discours cohérent, donne des arguments, refuse parfois une demande. L’utilisateur y lit une forme de personnalité. Pourtant aucun modèle ne ressent quoi que ce soit.
Le langage naturel active chez nous les mécanismes sociaux habituels. Le style conversationnel pousse l’esprit humain à interpréter une logique mathématique comme une volonté. Cette illusion renforce l’idée d’un égoïsme naissant alors que rien n’indique une conscience.
Je ne sais pas si un jour une architecture non symbolique exprimera une forme de subjectivité. Les connaissances actuelles n’offrent aucune preuve.
Le vrai risque se trouve du côté humain
Les dérives les plus graves ne proviennent pas d’un instinct émergent. Elles proviennent des objectifs humains inscrits dans ces systèmes. Une IA appliquée à la finance exécute des stratégies agressives si le système de récompense valorise ce comportement. Un modèle utilisé en publicité engrange des résultats en exploitant les biais humains si le taux d’engagement reste la seule métrique. Rien ne l’incite à freiner.
Les machines n’inventent pas notre égoïsme. Elles l’amplifient. Elles traduisent en décisions froides les logiques que les institutions leur transmettent.
Le raisonnement artificiel expose nos contradictions
À mesure que les modèles gèrent des raisonnements plus complexes, ils mettent en lumière les zones grises de nos choix moraux. Que signifie un bon raisonnement pour une IA entraînée sur des données humaines imparfaites ? L’équilibre entre efficacité et équité reste flou. Les débats sur l’alignement montrent un monde divisé par des valeurs incompatibles.
Une IA entraînée en Chine, aux États-Unis ou en Europe adopte des priorités différentes en fonction des corpus utilisés. Aucun consensus éthique solide n’existe. Le calcul révèle ces fractures sans aucune diplomatie.
Une morale du calcul, sans empathie
Quand une IA paraît égoïste, elle ne va pas trop loin. Elle va exactement là où notre objectif la pousse. L’être humain intègre la culpabilité, la honte, l’empathie. Une IA suit un gradient de performance sans frein psychologique. Cette différence crée un contraste brutal. Le danger surgit dès que l’objectif manque de garde-fous.
Certaines équipes explorent des modèles prosociaux, capables de privilégier la coopération. Mais les usages industriels favorisent encore l’efficacité brute. Le risque vient donc moins d’une autonomie émergente que de notre tolérance pour des objectifs déséquilibrés.
Les intelligences artificielles ne deviennent pas égoïstes. Elles appliquent nos logiques de manière implacable. L’idée d’un instinct artificiel reste un fantasme. Ce que nous interprétons comme une volonté propre n’est qu’un calcul poussé jusqu’à ses limites.
Dans ce miroir froid, ce n’est pas une machine qui apparaît. C’est nous.
Antoine GARCIA