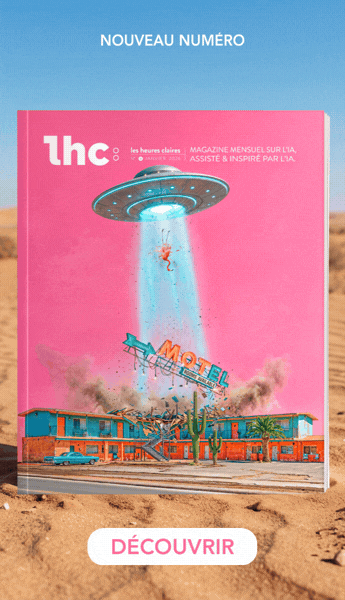Ce week-end, Julie Sweet a lancé une déflagration dans l’industrie. La PDG d’Accenture a assumé des licenciements secs pour les salariés jugés incapables d’apprendre les compétences IA nécessaires. L’entreprise réduit déjà ses effectifs tout en annonçant qu’elle écartera vite ceux qui n’entrent pas dans la trajectoire IA. Derrière le vernis corporate, le message tient en trois mots : se former ou dégager.
En France, le droit ne laisse aucune ambiguïté. L’article L6321-1 du code du travail oblige l’employeur à assurer l’adaptation des salariés à leur poste et à maintenir leur capacité d’emploi face aux évolutions technologiques. « La position de la PDG d’Accenture qui assume des licenciements pour incapacité à apprendre l’IA est juridiquement explosive en France. Cela viole directement l’article L6321-1 du Code du travail qui oblige l’employeur à former avant toute sanction », explique Arnaud Touati, co-fondateur et avocat associé chez #Hashtag Avocats. Le principe est clair : former d’abord, évaluer ensuite. Pas l’inverse.
Les juges rappellent régulièrement deux évidences. L’entreprise doit prouver qu’elle a mis en place des actions de formation réelles et traçables. Et l’argument d’un salarié « qui n’apprend pas » ne vaut rien si l’employeur n’a pas organisé un accompagnement sérieux.
Confondre inadaptation et motif économique est un dérapage dangereux. Le motif économique exige une suppression réelle d’emploi, une réorganisation ou des difficultés objectives. Glisser des cas individuels d’« inadéquation IA » dans cette catégorie reviendrait à contourner la loi. Le risque juridique grimpe aussitôt : licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire discrimination indirecte quand les plus expérimentés se retrouvent ciblés. « Les entreprises qui suivraient ce modèle s’exposent à des risques majeurs, licenciement sans cause réelle et sérieuse, discrimination indirecte notamment envers les seniors, détournement du motif économique et manquement à l’obligation de sécurité », alerte Arnaud Touati.
Une politique responsable suppose autre chose qu’un slogan d’« upskilling ». Cartographier les métiers menacés, fixer un calendrier de transition, proposer une formation certifiante sur le temps de travail, mettre en place du tutorat et ouvrir de vraies passerelles internes. Sans cela, le discours sur l’employabilité ressemble à un alibi pour ajustements comptables.
Les syndicats et les juristes décrivent la ligne de crête. L’insuffisance professionnelle ne tient qu’après un accompagnement documenté. Tant que le poste existe, un licenciement pour « inadéquation IA » heurte de plein fouet le droit français. Si l’emploi disparaît dans une réorganisation autour de l’IA, on bascule dans le motif économique, avec toutes ses obligations de reclassement et de plan social.
Sur le terrain de l’image, la formule « se former ou dégager » brise la confiance. Les talents restent là où les transitions se sécurisent, pas là où l’obsolescence est renvoyée sur l’individu. La course à l’IA ne justifie pas la course à l’éviction.
Augustin GARCIA
« L’IA ne justifie pas tout : le droit français fixe des bornes »
Face aux annonces de licenciements massifs justifiés par une prétendue « inadéquation IA », les juges français rappellent que la formation précède la sanction. Décryptons les zones grises et les risques juridiques qui guettent les employeurs tentés de confondre inadaptation individuelle et motif économique.
Pour démontrer qu’il a bien assuré l’adaptation d’un salarié face à l’IA, un employeur doit produire des preuves concrètes. Un plan de formation daté aligné sur le poste, les convocations, les feuilles d’émargement, les évaluations avant et après la formation, ainsi que les attestations et contenus des modules constituent la base. Les entretiens professionnels biennaux doivent être tracés et mentionner les actions décidées. L’accompagnement opérationnel doit aussi être documenté, qu’il s’agisse de tutorat, de temps dédié sur le temps de travail ou d’aménagements temporaires des tâches. Enfin, si l’IA modifie l’organisation ou les risques, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et du plan d’action associé s’impose.
Les juges n’exigent pas de durée minimale de formation ou d’accompagnement. Ils apprécient au cas par cas la réalité et la suffisance de l’effort fourni. En l’absence de formation, de tutorat ou de plan de retour à la performance, ils censurent la rupture pour insuffisance professionnelle.
Un plan de formation générique ne suffit pas. L’obligation vise l’adaptation au poste réel et au maintien de l’employabilité, ce qui implique un minimum d’individualisation selon les métiers, les profils et les technologies mises en place.
La frontière entre inadaptation individuelle et motif économique se situe dans la nature du poste. S’il n’y a pas suppression ou transformation d’emploi, ni modification essentielle du contrat refusée par le salarié, on reste sur l’insuffisance professionnelle, recevable seulement après un accompagnement sérieux. Le motif économique suppose une réorganisation avérée, avec suppression ou transformation du poste, et active alors l’obligation de reclassement.
Une annonce du type « se former ou dégager » expose l’entreprise à un risque de discrimination indirecte, notamment envers les salariés plus âgés. Si la politique produit un effet défavorable disproportionné, l’employeur doit justifier par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, sur le fondement des règles qui couvrent aussi la discrimination indirecte.
Avant un licenciement individuel lié à l’IA, l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement interne. La recherche doit être sérieuse, écrite et personnalisée, d’abord sur des postes de même catégorie ou équivalents, puis à défaut et avec accord du salarié, sur des postes de catégorie inférieure. Les offres doivent être précises et datées, et intégrer, si nécessaire, une courte formation d’adaptation. Cette recherche s’étend à l’ensemble de l’entreprise et du groupe.
Un entretien annuel qui fixe des objectifs d’acculturation à l’IA sans prévoir de moyens de formation précis fragilise l’employeur. Il peut constituer un manquement à l’obligation d’adaptation et décrédibiliser un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le risque existe aussi au regard de l’entretien professionnel, qui doit déboucher sur des actions concrètes et tracées. Plusieurs décisions récentes rappellent que, sans accompagnement effectif, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Les certifications externes (data, prompt engineering, cybersécurité) n’ont pas de valeur juridique obligatoire. Les juges regardent surtout les compétences effectives et l’effort d’adaptation fourni par l’employeur. Une certification peut servir d’indice, mais elle ne constitue pas un sésame.
Pour un salarié qui avance plus lentement dans l’IA, l’employeur doit formaliser les ajustements. Cela passe par l’actualisation de la fiche de poste, la fixation d’objectifs adaptés, la mise en place d’un plan d’accompagnement avec jalons, l’inscription des actions au plan de formation et la traçabilité du tutorat. Si l’ajustement touche un élément essentiel du contrat, il faut établir un avenant accepté par le salarié. Toute évolution des outils ou de l’organisation implique aussi une mise à jour du DUERP et du plan de prévention.
À ce stade, peu de décisions prud’homales visent spécifiquement l’IA. Mais les premiers signaux sont clairs. En 2025, plusieurs jugements rappellent que la sanction tombe si l’employeur ne démontre pas un accompagnement et une formation effectifs, avec une traçabilité rigoureuse et un reclassement recherché. Pour 2026, une vigilance accrue est attendue sur la discrimination indirecte liée à l’âge, face aux politiques d’« accélération IA » qui risquent d’écarter les salariés les plus expérimentés.